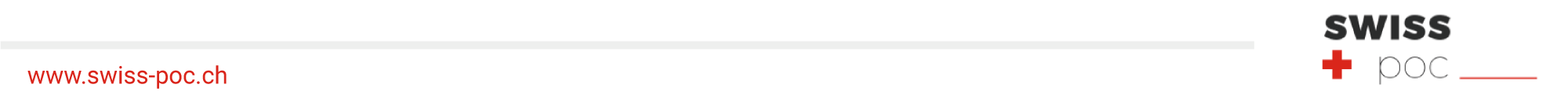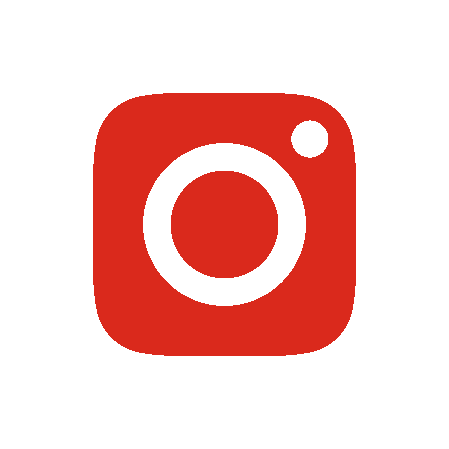Sécurité privée :
« Au début des années 2000, le recours à des entreprises militaires et de sécurité privées dans les conflits armés croît. Conscients des défis humanitaires, la Suisse et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) ont lancé une initiative commune, qui a abouti en 2008 à l’adoption du Document de Montreux. Son objectif est de définir comment le droit international s’applique aux activités de ces entreprises présentes sur le lieu de conflits armés. » (Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE, 2020).
En 1497, la compagnie des Cent-Suisses de la Garde est mise sur pied à Paris. C’est la première unité helvétique permanente. On assiste ensuite à une diversité du service des Suisses, qui servent en Espagne, Autriche, Hongrie, Italie etc.
« Parallèlement au service de France, principal demandeur, les autres services se développent. Les capitulations des cantons catholiques avec l’Espagne sont nombreuses jusqu’à la fin du 18ème siècle. On sert aussi en Grande-Bretagne, en Pologne, en Autriche (jusque vers 1740), en Savoie. Le service de Venise disparaît en 1719. » (Henry, 2017). Selon l’historien Wilhelm Bickel, il y aurait eu entre 900 000 et 1.1 million de soldats suisses ayant servi à l’étranger du 15ème siècle à 1850.
Guerres auxquelles les militaires suisses au service de la France ont participé
1480 : Louis XI engage un corps de 5 000 auxiliaires suisses.
1497 : Création par Charles VIII de la compagnie des Cent-Suisses de la garde.
1515 : Bataille de Marignan (13-14 septembre 1515) qui opposa le roi de France François 1er et ses alliés vénitiens aux suisses qui défendaient le duché de Milan. Les cantons suisses sont battus par la France. La bataille fit au total environ 16 000 morts en 16 heures de combat. En 1516 la Confédération et la France signent le traité de la « Paix Perpétuelle » et commence alors pour la Suisse une période de plus de 500 années sans guerre extérieure au pays.
1616 : Création du régiment permanent des Gardes Suisses par la régente Marie de Médicis, mère de Louis XIII, qui officieront comme « gardes extérieurs des palais ».
1709 : Bataille de Malpaquet, en Espagne. Des Suisses, servant à la fois dans les rangs français et dans ceux de la coalition (Empire, Prusse, Grande-Bretagne, Pays-Bas), s’entretuent : 8 000 d’entre eux sont massacrés.
1790 : Quelques troupes suisses sont en partie touchées par la vague révolutionnaire. Ainsi à Nancy, 300 soldats du régiment de Châteauvieux se mutinent.
1792 : Sur 900 Gardes suisses présents lors du massacre des Tuilerie le 10 août, environ 300 meurent sur place. Le licenciement des soldats restants, le 20 août, va de pair avec la chute de Louis XVI et l’abolition de la monarchie.
1803 : Une nouvelle capitulation est signée à Fribourg mettant à nouveau des régiments suisses au service de la France.
1812 : Lors de la campagne de Russie, menée par Napoléon, les Suisses perdent 9 000 hommes.
1830 : 300 Suisses se font tuer lors de la révolution de Juillet, en défendant les Tuileries et le Louvre. Dès août, les autorités suisses rappellent tous les régiments. » (Swissinfo, 2016).
Actuellement et depuis 1506, la Garde suisse pontificale protège le Pape et sa résidence au Vatican.
Mission des entreprises militaires et de sécurité privées
Le recours à ces entreprises pour fournir des services qui les rapprochent à des activités de combat a diminué. Elles restent cependant présentes dans les situations de conflits armés, où leurs principales missions sont la surveillance des bâtiments, la protection des personnes, l’escorte de convoi d’aide humanitaire, l’instruction des militaires et les missions de renseignements. Elles doivent, occasionnellement, participer à des combats.
La Suisse à l’origine du Document de Montreux
« Le 2 décembre 2005, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur les entreprises militaires et de sécurité privées. Ce rapport chargeait le DFAE de lancer un processus international visant à promouvoir le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme par les entreprises militaires et de sécurité privées opérant dans des zones de conflits armés. La publication de ce qui allait être connu sous le nom de « Document de Montreux » est le premier résultat obtenu conjointement par le DFAE et le CICR. Parallèlement, le DFAE encourage ces entreprises à s’autoréguler en s’appuyant sur le Document de Montreux et notamment en adhérant au Code de conduite international pour les entreprises de sécurité privées. Au niveau national, le DFAE s’attache à mettre en œuvre les bonnes pratiques du Document de Montreux dans le cadre de la loi fédérale sur les prestations de sécurité fournies à l’étranger. » (Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE, 2020). Actuellement en 2021, 58 États soutiennent le Document de Montreux ; 17 de ces États ont finalisé ensemble le document au cours de la réunion finale qui a eu lieu à Montreux (Vaud) le 17 septembre 2008.
Code de conduite international des entreprises de sécurité privées
Le Code définit des normes et principes professionnels fondés sur les droits de l’homme et sur le droit international humanitaire. Ce document, unique en son genre, est parti d’une initiative lancée par différents pays, dont la Suisse. Les entreprises s’engagent à respecter les droits de l’homme et toutes les législations en vigueur (y compris les lois locales et ou nationales). Le Code interdit notamment certaines activités comme la torture, la discrimination et la traite des êtres humains.
- Association basée à Genève
Après avoir été négocié entre toutes les parties prenantes, l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité a vu le jour en septembre 2013 sous la forme d’une association de droit suisse. Ce mécanisme de gouvernance et de contrôle indépendant est basé à Genève. Le Comité directeur se compose de représentants de gouvernements, d’entreprises et de la société civile. L’association veille à ce que les disposition du Code soient respectées par les entreprises privées de sécurité y ayant adhéré.